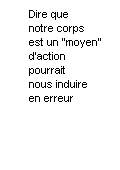|
...... |
...... |
...... |
||||||
|
...... |
V. AUTRES ASPECTS DE L'EXISTENCE CORPORELLE La dernière section, consacrée à la perception, donne une idée des conséquences que l'on peut tirer des conceptions phénoménologiques expliquées plus haut (sections II et III). Il y a aussi des conséquences à tirer pour tous les autres aspects de l'existence corporelle comme par exemple, le plaisir et la douleur, l'émotion, la sexualité, l'activité, l'expressivité, etc. Considérons seulement ces deux derniers points.
- On a déjà vu que la simple perception est un vécu préréflechi qui implique déjà une motricité corporelle : un objet est perçu proche ou lointain en fonction des possibilité corporelles de l'atteindre. Le corps vécu est un pouvoir d'opération originaire à partir duquel les choses nous apparaissent d'emblée sous l'angle de leur disponibilité (Zuhandenheit). Cette activité originaire du corps intervient non seulement dans la perception, comme nous avons vu, mais aussi dans toutes sortes de mouvements ou gestes du corps, qu'il s'agisse de gestes vitaux, de gestes créatifs ou de gestes expressifs. En disant que le corps vécu est source d'activité originaire, nous insistons sur le fait que l'activité spontanée préréfléchie est toujours au départ et au fondement de l'activité réfléchie. A cet égard, dire que le corps est un "moyen" d'action pourrait nous induire en erreur. Notons que notre action spontanée ne porte pas d'abord sur notre corps pour s'étendre ensuite aux choses mais que notre corps-sujet est directement absorbé par les choses dont il s'occupe. La présence active aux choses est vécue avant d'être pensée. La visée que le sujet spontané et anonyme dirige sur son objet n'est pas consciente d'elle-même et son objet n'est pas, pour elle, distinct. Aussi, cette visée est-elle "privée de toute souplesse, incapable de tout mouvement à l'intérieur d'elle-même" (De Waelhens, op. cit., p. 100). L'absence de réflexivité apparaît notamment dans le rapport spontané à l'instrument que, le cas échéant, nous utiliserons. Par exemple, je m'esquinte à attraper des fruits presque à ma portée et, comme certains singes, je puis même, dans ce mouvement spontané, utiliser un bâton si à l'instant j'en trouve une sous la main. -
Toute autre est l'activité manuelle réfléchie, tout autre devient alors
le rapport au corps et tout autre aussi devient
le sens de l'outil. Le corps m'apparaît à présent comme un instrument
exploitable, améliorable par l'exercice ou éventuellement remplaçable
par un outil extérieur. Quant
à l'outil, il ne fait plus un avec l'opérateur : il est conservé, comparé,
situé, classé parmi d'autres outils, contrôlé, entretenu, amélioré,
reproduit systématiquement, etc.
Ici intervient la technique.
La technique est amenée par la réflexion et elle consiste non
seulement à transformer la nature au moyen d'outils mais encore, grâce
à un détour par la science, à transformer notre mode de transformation
de la nature. La technique comporte toute une évolution : on passe
notamment du simple outil, qui est au service de la main, à la machine,
qui prend la place de l'homme et que
l'homme a tendance inversement à servir.
Les machines elles-mêmes évoluent : machines mécaniques, machines
énergétiques, machines informationnelles. - Il importe ici d'observer que notre rapport à l'outil technique, aussi sophistiqué que soit le niveau de son évolution, est toujours sous-tendu par et fondé sur l'expérience spontanée du corps-vécu, origine constante de nos prises sur le monde. Pour avoir limité son analyse à celle de la conscience réfléchie et au corps-objet, Descartes a connu des difficultés insurmontables pour penser une activité humaine qui est tout à la fois celle d'un sujet et celle d'un corps en prise avec le monde. Aujourd'hui encore, on a tendance à oublier l'incarnation originaire du sujet. C'est souvent le résultat de l'influence des techniques sur la vie quotidienne. D'où la réaction de certains et leur désir de retrouver des activité simples, traditionnelles, "authentiques", "naturelles", etc,
- Dire que le corps est un "moyen
d'expression" pourrait induire en erreur si l'on entend par là
que nous aurions par devers nous des intentionnalités (pensées, volitions,
sentiments) qu'ensuite nous extérioriserions par des gestes ou des mots
choisis à cet effet. L'expression spontanée ne sépare pas le
geste corporel et l'intention, aussi bien en soi-même que chez autrui.
Le poing levé n'est pas un simple signe de colère, celle-ci s'élève
dans l'élévation même du poing. Dans le dialogue des gestes, pleurs
et sourires qui relie le bébé à ses parents, l'enfant trouve spontanément
la réplique que la situation appelle. Les gestes ont sans doute la plupart
du temps une signification qui dépend de la culture, mais cette signification
culturelle est toujours déjà comprise avant d'être raisonnée. - Ce n'est qu'à la réflexion que nous pouvons
distinguer le geste corporel et sa signification afin de travailler
l'un et l'autre. Le comédien étudie son jeu et l'auteur choisit ses
mots. Ce travail et ce choix, pour importants qu'ils soient, sont toutefois
seconds par rapport à l'expressivité originaire immédiate par laquelle
seule nos gestes ont du sens. - La pensée réflexive ne surplombe jamais entièrement la parole. Nous savons que la pensée la plus intellectuelle ne peut se former sans passer par l'épreuve matérielle de la parole et de l'écriture et que cette expression corporelle est nécessaire à son évolution. Il en va de même des sentiments. Nous n'en connaissons aucun qui ne soit déjà en quelque manière exprimé. Le dernier aspect envisagé montre à l'évidence que l'on ne peut penser l'existence incarnée sans se référer au thème d'autrui. Les autres aspects renvoient également à ce thème. Par exemple, la perception. Que signifie, en effet, que je perçois réellement un objet sinon que celui-ci n'est pas pour moi seulement, comme le serait un objet que j'imagine? (D'ailleurs, le pour-moi-seulement de l'imagination présuppose la perception et donc encore autrui). Nous devons préciser la portée de la relation à autrui présente dès l'origine de l'expérience du corps propre.
________________________________________________ |
...... |
||||||