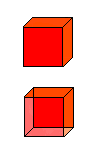|
...... |
...... |
...... |
||||||
|
...... |
II. Une
nouvelle description de la conscience III. La primauté du corps vécu ou corps sujet V. Autres aspects de l'existence corporelle
I. LA CHOSE PENSANTE ET LE CORPS OBJET 1. Dans la tradition philosophique, Descartes est réputé le philosophe de la subjectivité (ce primat de la subjectivité, avons-nous vu, est en accord avec la "modernité"). Toutefois, en ce qui concerne le corps et l'âme, la méthode cartésienne débouche sur un dualisme insurmontable. Reprenons donc ce problème là où Descartes l'a laissé. L'évidence du cogito est comprise par Descartes comme celle d'une substance pensante. Cette évidence semble auto-suffisante et repliée sur elle-même. Elle paraît suffisamment justifiée par l'adéquation entre la cogitatio et le cogitatum. Elle paraît ne rien devoir à l'existence corporelle (je puis l'avoir même si je doute de mon corps) et ne pas y renvoyer (tout au plus enveloppe-t-elle l'idée que j'ai un corps, mais pas sa réalité). Ce n'est que par un double détour, celui de la véracité divine et celui du critère de l'idée claire et distincte, que Descartes parvient à valider dans une certaine mesure le sentiment d'avoir un corps. L'idée claire et distincte des choses corporelles étant leur étendue, le fait d'avoir des parties extérieures entre elles, le corps est assuré en tant que res extensa, ce qui le rend absolument hétérogène à la res cogitans. Dans ces conditions, on ne voit pas comment comprendre l'unité d'action du corps et de la conscience et encore moins comment le sujet peut agir sur son environnement physique ou social. Dire que le point d'union serait un endroit du corps (la glande "pinéale") n'explique rien parce qu'un endroit est tout aussi hétérogène à la pensée que l'âme au corps. Dire que le corps et l'âme sont harmonisés par l'effet de la puissance divine est un renvoi au mystère qui ne fait pas progresser davantage notre compréhension. Le corps apparaît inévitablement comme une machine, un outil, dont je puis, grâce à Dieu, disposer. Descartes reconnaît pourtant que, dans le sentiment naturel et dans l'expérience de la vie courante, "je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un pilote en son navire" car "un pilote aperçoit par la vue si une chose se rompt dans son vaisseau" tandis que moi, je ressens mes blessures (cfr. sixième méditation). Mais ce fait, Descartes ne peut que l'attribuer à des "façons confuses de penser", qui demeurent secondaires par rapport aux aspects purement mécaniques qui seuls peuvent être justifiés en raison. 2. Cette manière de concevoir le corps comme un instrument à utiliser et à maîtriser n'est nullement propre à Descartes. Elle s'inscrit tout d'abord dans une longue tradition intellectualiste ou spiritualiste qui remonte à Platon et qui fut renforcée par certaines formes de théologie. Elle subsiste dans la culture contemporaine.
Le fait culturel de la représentation du corps comme objet, machine ou instrument, résulte aussi de l'objectivisme scientifique qui, pourtant, apparemment (mais apparemment seulement) n'a pas grand chose à voir avec la tradition spiritualiste. L'essor de notre société industrielle est lié au développement des sciences et des techniques. L'optimisme engendré par la fécondité de la science a fait oublier que son objet est en réalité construit à partir d'axiomes a priori. Cette négligence caractérise
ce que l'on convient d'appeler l'objectivisme scientiste. L'erreur du
scientisme ne réside pas dans la pratique de l'objectivité scientifique
mais bien dans la prétention totalitaire qui consiste à identifier l'être
même à l'objet de science, connu ou connaissable. Kant dénonçait déjà
ce type d'identification en refusant de confondre le phénomène et la
chose en soi. Appliqué au corps humain, l'objectivisme consiste fréquemment à le concevoir comme un organisme biologique. Ceci est un léger progrès par rapport au simple mécanisme cartésien dans la mesure où l'on reconnaît une sorte d'unité interne qui fait concourir les organes au maintien de l'individu vivant, mais ce concours reste conçu comme extérieur à la subjectivité. La maladie se ramène à un dysfonctionnement ou à une lésion organique. La compréhension du symptôme s'effectue indépendamment de ce que le malade dit et pense. On échoue à comprendre les maladies psychosomatiques et l'on exclut d'ailleurs que toute affection puisse être à la fois physique et psychique. L'homme sain serait celui qui dispose aisément de son corps en vue des fins qu'il conçoit.
________________________________________________ |
...... |
||||||