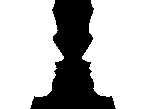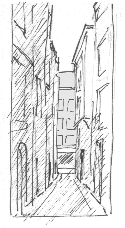|
...... |
...... |
...... |
||||||
|
...... |
IV. LE CORPS PERCEVANT 1. De nombreuses études de physiologie et de psychologie expérimentale ont considéré que la perception commençait par des impressions nerveuses, donnant lieu à des simples sensations subjectives, et s'achevait dans une activité intelligente associative permettant d'avoir affaire à un véritable objet de perception. Les sensations ne seraient donc pas encore des perceptions mais de simples conséquences ponctuelles subjectives dues à l'influence causale d'excitants physiques. Dans cette perspective, on s'est appliqué à étudier le lien excitant-sensation. D'où certaines lois empiriques établies au siècle dernier comme celles de Weber sur le seuil absolu (il n'y a sensation qu'à partir d'un certain degré de l'excitant) et le seuil différentiel (la plus petite différence que l'on puisse sentir entre deux excitants est une fonction constante du premier) ou celle de Fechner (la sensation croît comme le logarithme de l'excitant), c'est-à-dire qu'elle progressera arithmétiquement alors que l'excitant progresse géométriquement). Les perceptions d'objet, quant à elles, impliqueraient non seulement d'en avoir des sensations mais encore de les interpréter de façon synthétique. Pour cette synthèse il faudrait une intervention de l'intelligence, le jugement, à l'occasion des sensations ponctuelles. La perspective objectiviste liant la sensation à un phénomène organique rejoint paradoxalement la conception intellectualiste et cartésienne de la perception : celle-ci serait un acte d'interprétation posé par l'esprit à l'occasion des sensations qui résultent de l'affection des organes des sens (cf. l'exemple du cube donné plus haut et qui a faire dire à certains : voir, c'est juger qu'on voit).
L'intelligence en jeu dans la perception ajoute moins qu'on ne croit aux données de la sensation. En fait, les gestalistes refusent de distinguer sensation et perception. J'ouvre les yeux non sur une poussière d'impressions mais sur un champ visuel d'emblée organisé en figure sur fond. Cette structuration immédiate s'effectue selon la loi de la "bonne forme" : la forme la plus simple et la plus cohérente s'impose. La sensation n'est donc pas une simple résultante organique ponctuelle, elle est d'emblée porteuse de sens (comme la perception elle-même). 3. La phénoménologie de la perception a beaucoup retenu de la Gestalttheorie. Cependant, elle ajoute que les "formes" ne jouent pas indépendamment de l'intentionnalité de la conscience.
A ce niveau, qui est celui de l'intentionnalité préréfléchie, le monde perçu est Lebenswelt au sens décrit plus haut et, selon les termes de Heidegger, la Zuhandenheit (disponibilité pour la main) prime la Vorhandenheit (simple présence). C'est parce que je puis l'emprunter que je vois devant moi une rue qui s'éloigne en profondeur et non une rue qui se rétrécit comme le triangle formé sur la rétine. De même, c'est en raison de mon comportement que la "bonne forme" du ciel au-dessus des maisons constitue en réalité un fond pour celles-ci. Il apparaît donc que la perception est la présence du sujet aux choses par et dans un vécu corporel où la conscience intentionnelle ne se distingue pas de son corps. Ceci ne peut se comprendre que si l'on se réfère à l'expérience préréflexive de la conscience plutôt qu'à l'expérience scientifique du corps-objet effectuée par une conscience réflexive. De même que , dans l'expérience vécue du corps, je ne suis pas pour moi distinct de lui, dans la perception vécue, je ne suis pas pour moi distinct de ce que je perçois. A ce niveau, percevoir une maison, c'est y être absorbé même si, en fait, cela ne se peut que parce que je suis transcendant par rapport à elle. L'ouverture du corps-sujet percevant est corrélative, du côté noématique, à un monde primordial déjà là et déjà doué de sens avant toute réflexion ou objectivation scientifique. "Qu'avons-nous donc au commencement? Non pas un multiple donné avec une aperception synthétique qui le parcourt et le traverse de part en part, mais un certain champ perceptif sur le fond de monde. Rien ici n'est thématisé. Ni l'objet ni le sujet ne sont posés. On n'a pas dans le champ originaire une mosaïque de qualités, mais une configuration totale qui distribue les valeurs fonctionnelles selon l'exigence de l'ensemble, et par exemple (...), un papier "blanc" dans l'ombre n'est pas blanc au sens d'une qualité objective, mais il vaut comme blanc. Ce qu'on appelle sensation n'est que la plus simple des perceptions, et, comme modalité de l'existence, ne peut, pas plus qu'aucune perception, se séparer d'un fond qui, enfin, est le monde. Corrélativement, chaque acte perceptif s'apparaît comme prélevé sur une adhésion globale du monde" (MERLEAU-PONTY, op. cit., p. 274). La raison fondamentale pour laquelle la perception mienne n'est pas un fait psycho-physiologique objectif tient en ce qu'elle est la condition d'accès obligée à tout ce que la science objective peut m'apprendre sur la perception et sur le monde perçu. En effet, "quelles que soient les précautions prises, les
méthodes mises en oeuvre, les dispositifs ou l'instrumentation appliqués,
les résultats, en dernière
analyse, devront toujours et nécessairement être préparés, obtenus,,
lus, constatés et communiqués par des actes de connaissance qui s'insèrent
tout entiers dans le monde de l'expérience non-scientifique et
"quotidienne". Pour finir, l'astronome, le physicien,
l'anatomiste, ne peut édifier sa science qu'en lisant les données fournies
par un appareil (même, si cet appareil feint de supprimer dans son fonctionnement
toute référence aux organes de nos sens) exactement
comme je lis un livre (...)" (DE WAELHENS, op. cit.,
p. 51).
________________________________________________ |
...... |
||||||