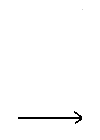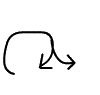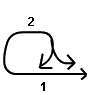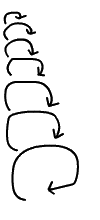|
...... |
...... |
...... |
||||||
|
...... |
II. UNE NOUVELLE DESCRIPTION DE LA CONSCIENCE Il ne faut pas nécessairement abandonner le point de vue de la conscience pour sortir de l'impossibilité où se trouvait Descartes de penser l'incarnation du sujet. Il suffirait peut-être de cesser de la concevoir comme une substance autosuffisante et pleinement réflexive. C'est ce qu'ont tenté de faire les phénoménologues, Husserl (1859-1938) et Heidegger (1889-1976) en Allemagne, Sartre (1905-1980) et Merleau-Ponty (1908-1961) en France, De Waelhens (1911-1981) en Belgique. La phénoménologie (le sens du mot n'est pas le même ici que chez Hegel) est une nouvelle manière de décrire la conscience et ses contenus. Les thèses essentielles de la phénoménologie, dont vont s'inspirer ce chapitre et les deux suivants, peuvent être ramenés schématiquement à quatre points. 1. La conscience est intentionnelle et par là donatrice de sens
"La conscience, écrit Merleau-Ponty, est de part en part transcendance", c'est-à-dire dépassement de soi dans la chose visée, son objet. Il n'y a pas d'intériorité pure de la conscience, de subjectivité purement réduite à elle-même. Je puis, certes, penser à moi, mais même dans ce cas, l'intentionnalité que j'exerce (cogitatio) porte sur un objet (cogitatum) qui ne s'identifie pas à cette intention. La conscience n'est pas un objet mais une ouverture, une orientation (noèse) vers ce qui constitue son pôle objectif (noème). Comme d'autre part il n'y a d'objet que pour une conscience, la conscience est, d'après Husserl, constituante. En disant cela, Husserl ne se prononce pas sur la question de savoir s'il existe des choses hors de moi indépendamment de ma visée. Il appelle "réduction" le fait de laisser en suspens cette question qui oppose les philosophes réalistes et des philosophes idéalistes. Ce qui l'intéresse est le sens que la conscience confère à ses noèmes. Cette constitution de la chose est la "Sinngebung". Il y a l'objet perçu, l'objet imaginé, l'objet utile, l'objet troublant, etc, qui sont corrélatifs à la conscience percevante, imaginante, pratique, émue, etc. On peut caractériser ces différentes intentionnalités ainsi que les "essences régionales" qui y correspondent. Cette démarche descriptive portant sur les manières d'apparaître mérite bien le nom de "phénoménologie" (à ne pas confondre avec la phénoménologie hégélienne). Il s'agit par là de dépasser ce que Husserl appelle "l'attitude naturelle" et qui consiste en une tendance dogmatique à oublier que nous constituons les choses quant à leur signification (même si, à l'intérieur de cette constitution, il importe de distinguer notamment la constitution de l'objet perçu et la constitution de l'objet imaginé). 2. L'intentionnalité peut être pré-réflexive ou réflexive
La conscience réflexive n'est pas seulement consciente, elle prend conscience simultanément de son objet, qu'elle distingue d'elle-même, (qu'elle "thématise"), et d'elle-même en tant que distincte de lui (elle est "thétique de soi"). Elle sait ce qu'elle fait. Ce niveau est celui de la prise en charge, de la parole et de la responsabilité où le mot "je" apparaît. Le rapport à l'obstacle et le rapport à autrui semblent nécessaires au passage du premier au second niveau.
________________________________________________ |
...... |
||||||