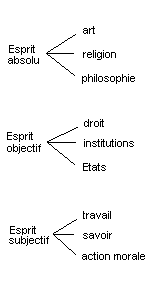|
...... |
...... |
...... |
||||||
|
..... |
IV. LE RENVOI A LA DIALECTIQUE Une philosophie de l'histoire se développe au XIXe s. selon laquelle les hommes sont entraînés dans un devenir collectif d'eux-mêmes. La stabilité d'une nature humaine sera donc exclue par principe. 1. La méthode dialectique Le mot "dialectique" a revêtu des sens divers (Aristote : logique de l'argumentation destinée à convaincre; Platon : effort pour remonter du sensible aux idées et des idées inférieures aux idées supérieurs; Kant : errements de la raison pure lorsqu'elle use des catégories hors du camp de l'expérience possible; etc...). Avec Hegel (1770-1831), le mot prend un nouveau sens : mouvement consistant à reconnaître l'opposition et l'inséparabilité des contraires, découvrir le principe de leur unité dans un moment (idée ou réalité) supérieur et ainsi de suite jusqu'à atteindre, par ce développement, la totalité. C'est par celle-ci seule qu'une chose peut vraiment être et être comprise. "Le vrai est le tout" déclare la préface de la Phénoménologie de l'Esprit (1807). On reconnaît dans cette méthode le célèbre schéma d'explication triadique : thèse, antithèse, synthèse (Aufhebung : reprise et dépassement des contraires). La totalité est en fait totalisation, devenir au travers des oppositions. Les oppositions sont les moment de "négativité" de la dialectique. Toute réalité partielle est appelée "abstraite" en un sens nouveau du terme : elle est abstraite (isolée) par rapport à la totalité qui seule est "concrète". Il importe d'ajouter que pour Hegel, la méthode fait corps avec le contenu : la dialectique est aussi bien le mouvement même du réel, dans lequel toute la réalité partielle se pose en s'opposant. A l'opposé, Marx développe un matérialisme dialectique. La totalité en totalisation n'est pas autre chose que la vie matérielle économique. Si cela ne nous apparaît pas d'emblée, c'est que l'histoire de la manifestation de la vie matérielle n'est pas terminée. A la fin de l'histoire (qui sera la fin de la lutte des classes dans la vie économique), la vie matérielle apparaîtra dans sa vraie nature, englobant ce qui, auparavant, avait l'apparence d'une activité spirituelle indépendante (idéologie). Marx entend par idéologie une pensée (religieuse, morale, politique, etc.) qui opère dans l'illusion d'être autonome par rapport aux intérêts économiques alors qu'en fait la vie matérielle conditionne l'ensemble de notre existence. Notons que le terme est ici péjoratif : "dans toute l'idéologie, les hommes et leurs rapports nous apparaissent placés la tête en bas comme dans une camera obscura" (cf. L'ouvrage de 1846 intitulé L'idéologie allemande, 4e fragment). 2. Résultat concernant la nature humaine "L'histoire n'est qu'une transformation continue de la nature humaine". Hegel aurait sans doute souscrit à cette phrase de Marx, (mais probablement pas au titre de l'ouvrage dont elle est extraite : "Misère de la philosophie" - 1847). Pour Hegel, l'humanité toute entière est en cause dans une progression de la conscience universelle qui, de génération en génération, entraîne les individus considérés comme parties d'un tout plus vaste qui les englobe et les modifie au cours de ses mutations. Que la nature humaine soit en devenir collectif apparaît également chez Marx, mais sur une base "matérielle" qui doit se comprendre en termes de production ainsi que l'explique l'extrait suivant de l'Idéologie allemande de 1846 (2e fragment). "On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion et par tout ce qu'on voudra. Eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux dès qu'ils commencent à produire leurs moyens d'existence, pas en avant qui est la conséquence même de leur organisation corporelle. En produisant leurs moyens d'existence, les hommes produisent indirectement leur vie matérielle elle-même. La façon dont les hommes produisent leurs moyens d'existence dépend d'abord de la nature, des moyens d'existence déjà donnés et qu'il leur faut reproduire. Il ne faut pas considérer ce mode de production de ce seul point de vue, à savoir qu'il est la reproduction de l'existence physique des individus. Il représente, au contraire, un mode déterminé de l'activité de ces individus, une façon déterminée de manifester leur vie, un mode de vie déterminé. La façon dont les individus manifestent leur vie reflète très exactement ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont coïncide donc avec leur production, aussi bien avec ce qu'ils produisent qu'avec la façon dont ils produisent. ce que sont les individus dépend donc des conditions matérielles de leur production". 3. Commentaires a. Sur le devenir Les objections de la philosophie dialectique de l'histoire en ce qui concerne la nature humaine portent sur la stabilité que la notion de nature implique. Il n'y a de stabilité que négative. Certes, on n'exclut pas qu'il existe durablement des hommes et qu'ils se distinguent, par exemple, des (autres) animaux. Toutefois, le propre de la réalité humaine est son historicité même, comprise comme production collective en soi. La différence spécifique consiste uniquement dans le fait qu'elle est elle-même en question et se réalise dans l'histoire. L'homme ne se définit dès lors par rien sinon par le fait que sa définition est en devenir collectif. Cette philosophie est parfois qualifiée d'historicisme. Dans cette optique, l'histoire devient le principe explicatif fondamental et elle est régie par des lois propres (notamment celle de la contradiction dynamique). Cet historicisme est téléologique parce que l'histoire est finalisée : le tumulte des événements est orienté vers un état d'accomplissement, qu'il s'agisse de la fin de l'histoire selon Hegel (tout le réel sera rationnel et tout le rationnel réel) ou de la société sans classe selon Marx. La fin donne ainsi un sens aux tragédies que nous vivons (la philosophie discerne, dit Hegel, "la rose sur la croix du présent"). b. Sur la totalité Le devenir humain compris par la philosophie dialectique de l'histoire n'est pas un projet personnel, libre et responsable. L'individu n'est, en somme, que la figure que réalise en lui l'esprit universel (Hegel) ou le mode de production économique qui le détermine (Marx). D'autres philosophes contestent fortement cette philosophie de la totalité. L'existentialisme revendique le sens de la liberté individuelle. S. Kierkegaard, un des initiateurs de ce courant, développe une philosophie foncièrement anti-hégelienne. Aujourd'hui les "nouveaux philosophes" (A. Glucksmann, B.-H. Levy) dénoncent les développements du marxisme qui ont permis le totalitarisme stalinien : l'adhésion dogmatique à des prétendues lois de l'histoire conduit à l'écrasement des individus. E. Levinas, un phénoménologue français contemporain, considère que la signification d'autrui dépasse infiniment et contredit toute compréhension globale de l'histoire; "il est, par lui-même et non point par référence à un système" (Totalité et infini, La Haye, Nijhoff, 1961, p. 47).
________________________________________________ |
..... |
||||||